|
1° Les
capitulaires – Charlemagne savait que les lois étaient la meilleure
garantie de stabilité au sein d’un Etat. Il décida donc de réformer les
anciennes, telles que la loi Salique,
mais aussi d’en proclamer de nouvelles. Ces textes législatifs reçurent le
nom de capitulaires (car ils étaient divisés en plusieurs chapitres,
ou capitula).
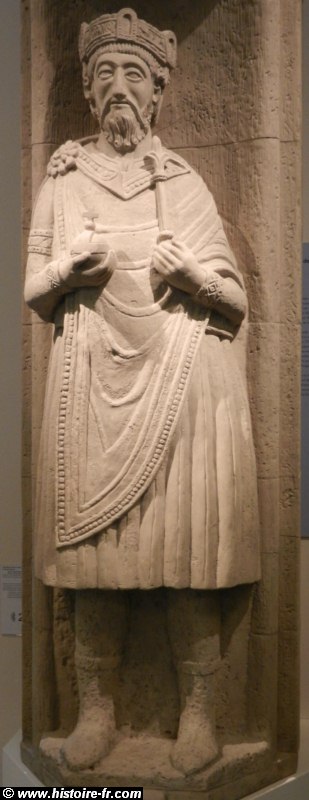
Statue de Charlemagne, Deutsches historisches museum, Berlin.
Les capitulaires étaient
élaborés lors des assemblées du champ de Mars, composées d’évêques et de
seigneurs, que Charlemagne convoquait au printemps.
A noter que ces assemblées
législatives ne ressemblaient en rien à notre actuelle Assemblée nationale
: ainsi, non seulement les représentants des provinces n’étaient pas des élus
comme aujourd’hui ; en outre, ils ne faisaient guère que suivre les décisions du
souverain, qui dirigeait tout.
Au cours de son règne,
Charlemagne fit promulguer une centaine de capitulaires, régissant des domaines
aussi divers que variés (religion, politique, droit pénal, droit civil,
administration, armée, finances, etc.).
Les capitulaires les plus connus
aujourd’hui sont le de partibus Saxonie (ou capitulaire saxon, promulgué en
785), punissant de mort les Saxons ne se convertissant pas au christianisme ; l’Admonitio
generalis (ou exhortation générale, datant de 789), prévoyant la
création d’écoles dans les églises et cathédrales, afin d’instruire les enfants
des hommes libres ; enfin, le de Villis (promulgué vers 800) avait pour
objectif de réformer l’agriculture, prévoyant la culture de 90 plantes
spécifiques dans les domaines royaux (villis en latin).
A noter qu’en règle générale,
les capitulaires énonçaient une série de décisions qui furent peu ou prou
appliquées selon les différentes provinces de l’Empire.
2° Charlemagne et
le clergé – Au VIII° siècle, l’Eglise et l’Etat étaient étroitement unis
(Pépin III, sacré roi des Francs par le pape, avait donné naissance au Etats
pontificaux).
Charlemagne, tout comme son
père, eut donc à cœur de remplir ses obligations envers l’Eglise.
L’on peut toutefois constater
que le roi des Francs ne fit qu’appliquer des dispositions déjà prises par Pépin
III au cours de son règne (plusieurs capitulaires furent consacrés au
rétablissement de la morale ecclésiastique).
Ainsi, les évêques indignes
furent déposés ; défense était faite aux clercs de porter les armes, de chasser,
de fréquenter les tavernes ou de revêtir l’habit laïque ; enfin, la dîme,
irrégulièrement payée, dut l’être désormais avec exactitude.
Par ailleurs, Charlemagne
intervint sur les questions théologiques, condamnant l’iconoclasme byzantin et
la théorie de l’adoptianisme (certains évêques d’Espagne musulmane
avançaient la thèse selon laquelle le Christ ne serait devenu fils de Dieu que
par adoption, suite à son baptême).
Par ailleurs, le roi des Francs
se prononça en faveur du filioque, doctrine latine considérant que le
Saint esprit procède du père, mais aussi du fils.
3° Les quatre
conciles de 813 – En 813, l’Empereur organisa une série de conciles, en
Gaule, afin de régler un certain nombre de questions religieuses.
Le concile de Tours (mai
813) consacra la fin des homélies en latin. Ces dernières devaient être
prononcées soit en langue romane,
en Gaule, soit en langue tudesque, en Germanie (l’objectif était que tous
les fidèles puissent comprendre ce que disait le prêtre).
Le concile de Mayence
(juin 813) ordonna la création d’écoles rurales pour la formation des prêtres ;
en outre, l’interdiction de se marier pour cause de consanguinité fut élargie
aux cousins issus de germain.
Les deux derniers conciles
furent moins importants. A Arles, les prélats abordèrent des questions de foi,
sans prendre de décisions ; A Chalon, l’équivalence entre les pèlerinages de
Tours et de Rome furent prononcés.
Les dispositions des quatre
conciles furent finalement ratifiées lors d’une assemblée tenue à
Aix-la-Chapelle, en fin d’année 813. A cette occasion, Charlemagne couronna
Empereur son fils Louis, dont les frères étaient décédés (à noter que le pape ne
participant pas à la cérémonie).
4° Politique
économique de Charlemagne – A l’instar des questions religieuses,
Charlemagne eut une politique économique similaire à celle de son père.
a) L’adoption des trois
monnaies : ainsi, rappelons que Pépin avait uniformisé le poids et la forme
du denier
d’argent
(les monnaies en or furent définitivement abandonnées sous le règne de
Charlemagne, ce métal étant devenu trop rare en occident).
L’Empereur d’occident,
poursuivant la politique économique de son père, adopta le système des trois
monnaies, qui subsista jusqu’à la Révolution française. L’unité de base était la
livre (l’équivalent de 489 grammes d’argent), divisée en 20 sous, chacun
comprenant 12 deniers (240 deniers valaient donc une livre).
A noter que jusqu’au XIII°
siècle, seule le denier fut une monnaie réelle, la livre et le sou servant de
monnaies de compte.

Deniers de Charlemagne, fin du VIII°
siècle, Bode museum, Berlin.
En 805, afin de lutter contre
les faux-monnayeurs, Charlemagne promulgua un capitulaire n’autorisant la frappe
de la monnaie que dans les palais du roi.
b) Les ressources économiques
de Charlemagne : nous avons vu précédemment que les principales ressources
économiques du roi des Francs provenaient du butin de guerre.
A
cette date, et ce depuis la fin de l’époque mérovingienne, les impôts ne
rentraient plus dans les caisses de l’Etat. En effet, cette manne financière
était confisquée par les comtes.
L’autre ressource de Charlemagne provenait du domaine royal, mais ce dernier
avait été considérablement réduit depuis les legs de Charles Martel à ses
vassaux.
Ainsi,
le domaine royal n’apportait à la couronne que des prestations en nature,
tout juste suffisantes pour permettre le ravitaillement de la Cour.
5° Les tribunaux
– Comme au temps des Mérovingiens, il existait deux catégories de justice à
l’époque de Charlemagne, l’une royale, l’autre seigneuriale (ou
domaniale).
a) La justice royale : la
justice royale s’étendait en théorie sur les vassaux du roi, sur les hommes
libres, et sur tout individu surpris en faute hors d’un grand domaine (en
réalité, elle ne fut en vigueur que sur le domaine royal, qui à l’époque de
Charlemagne était déjà de taille réduite).
Depuis l’époque mérovingienne,
la base du droit était la loi Salique, très inspiré des anciennes coutumes
germaniques. Les coupables devaient donc payer une amende, le Wergeld
(c'est-à-dire le prix du sang), permettant à l’origine d’échapper à faida,
vengeance orchestrée par les proches de la victime (toutefois, la société
franque ayant considérablement évolué depuis Clovis, les amendes ne
servaient plus à dédommager les familles mais à faire rentrer de l’argent dans
les caisses).
Par ailleurs, en raison de
l’annexion de plusieurs anciens royaumes, à la loi Salique vinrent s’ajouter la
loi des Francs Ripuaires, des Burgondes, des Alamans, etc. Non seulement ces
lois étaient terriblement désuètes ; mais en outre, leur application entrainait
un désordre terrible, car chaque province payait une amende différente.
Charlemagne, remaniant la loi
Salique,
décida d’établir partout un tarif uniforme.
b) La justice seigneuriale :
La justice seigneuriale (ou domaniale) était celle que le comte exerçait à
l’intérieur de ses domaines.
Ce dernier bénéficiait d’une
grande indépendance depuis la fin de l’époque mérovingienne ; toutefois, les
missi dominici, envoyés de Charlemagnes, avaient le pouvoir de casser une
décision de justice s’ils la jugeaient inique ou trop sévère.
La justice était gratuite, mais
le comte avait droit au tiers des amendes prononcées par son tribunal, le reste
allant (en théorie) au trésor du roi.
Ce n’est qu’à compter du XIII°
siècle que la justice royale commença à s’affirmer vis-à-vis de la justice
seigneuriale.
c) La justice ecclésiastique :
outre la justice royale et la justice seigneuriale, il existait une justice
ecclésiastique, exercée par les diocèses.
En effet, les clercs étant
soustraits à la justice civile depuis le concile d’Orléans, qui s’était
tenu en 511.
Ainsi, ces derniers ne pouvaient être jugés que par un tribunal ecclésiastique,
en vertu du droit canonique.
|