1° Louis II le Bègue, roi de Francie occidentale (877 à 879) – Charles le Chauve, de son
mariage avec
Ermentrude, fille
d’Eudes, comte d’Orléans,
avait eu plusieurs fils : Louis II le Bègue ; Charles l’Enfant (décédé
en 866) ;
Carloman (après s’être révolté contre son père, il fut
aveuglé et placé dans un monastère
)
; et
Lothaire le Boiteux (ce dernier, en raison de son infirmité,
fut destiné à la vie monacale).

Ermentrude, école française du XIII° siècle, château de Versailles,
Versailles.
Ses frères étant morts
ou cloîtrés, Louis II récupéra donc l’héritage de son père.
A noter toutefois qu’il
ne bénéficia pas de la dignité impériale (qui ne fut plus portée
jusqu’en 881) ; et le royaume d’Italie fut cédé à Carloman, roi de
Bavière.
Par ailleurs, Louis II
fut contraint de faire face à l’hostilité de Richilde, deuxième
épouse de Charles le Chauve ; en outre, l’autorité du nouveau souverain
fut contestée par de nombreux comtes.
Louis II, couronné en
décembre 877 par Hincmar, archevêque de Reims, fut sacré une seconde
fois à Troyes en septembre 878 par le pape Jean VIII.
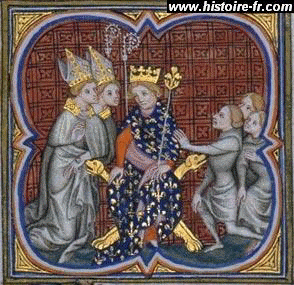
L
ouis
II le Bègue, enluminure issue des Grandes Chroniques de France, XIV°
siècle,
Bibliothèque Nationale, Paris.
Cependant, ce souverain
n’eut jamais une grande autorité, mourant en avril 879, seulement deux
années après son accession au trône.
2° Louis III et Carloman II,
rois de Francie occidentale (879 à 880) – Louis II le Bègue, de son
mariage avec Ansgarde, fille du comte de Bourgogne, avait eu deux
fils : Louis III (né vers 863) et Carloman II (né vers
867).
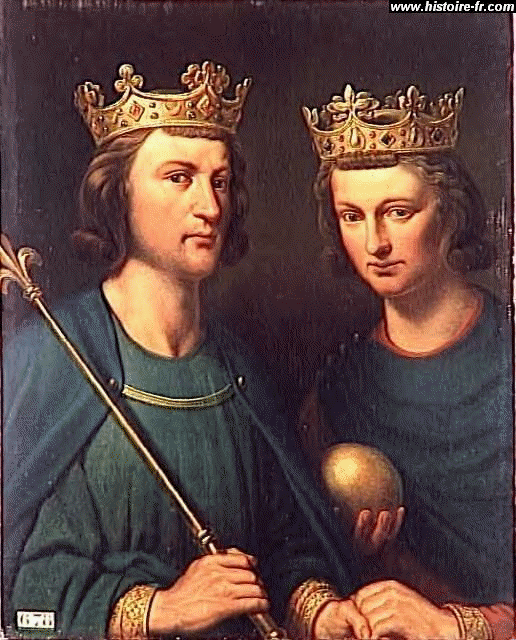
Louis III et Carloman régnant ensemble,
par le baron STEUBEN, 1837,
château de Versailles, Versailles.
Suite à la répudiation de son épouse, le roi
de Francie occidentale s’était remarié avec Adélaïde, fille d’Adalhard,
comte de Paris. Cette dernière eut un enfant posthume, Charles III le
Simple.
Toutefois, le second mariage de Louis le Bègue étant jugé illégitime par
l’Eglise, l’enfant fut écarté de la succession.
a) Le partage de 879 : suite à la mort
de leur père, Louis III et Carloman II furent couronnés par Anségise,
archevêque de Sens, dans l’abbaye Saint Pierre et Saint Paul de
Ferrières, près de Montargis (septembre 879).
Puis, en mars 880, les deux adolescents
procédèrent au partage du royaume : Louis III, l’aîné, reçut la
Neustrie ; son frère Carloman, quant à lui, eut l’Aquitaine, la
Septimanie et une partie de la Bourgogne.
b) Le règne de Carloman de Bavière (876 à
880) : nous avons vu précédemment que le roi Louis le Germanique, à
sa mort, avait divisé son royaume entre ses fils : Carloman, roi de
Bavière ; Louis le Jeune, roi de Saxe ; et Charles le Gros, roi
d’Alémanie.
Toutefois, l’aîné fut rapidement la cible de
ses deux frères. Ainsi, en 879, Charles le Gros s’empara de La péninsule
italique, étant couronné roi d’Italie ; Louis le Jeune, quant à lui,
s’arrogea la Bavière, mais aussi la Lotharingie occidentale (qui
appartenait à Louis II le Bègue).
Carloman mourut l’année suivante, en septembre
880, frappé de paralysie. Ce dernier ne laissait qu’un fils illégitime,
Arnulf, qu’il avait eu avec sa maîtresse Litzwinde. Agé
d’une trentaine d’année, il fut écarté de la succession, mais récupéra
toutefois le duché de Carinthie.
c) Le traité de Ribemont (880) : en
880, les quatre souverains carolingiens décidèrent de se rencontrer à
Ribemont, afin de mettre un terme aux agitations qui déchiraient
l’ancien Empire de Charlemagne : les Normands, qui après quelques années
d’accalmie, revenaient à la charge ; Boson, duc de Provence, qui
avait pris le titre de roi ;
et Hugues, fils illégitime de Lothaire II, qui multipliait les raids en
Lotharingie.
Louis III et Carloman, soucieux de faire face
aux désordres, décidèrent d’acheter la neutralité de Louis le Jeune,
reconnaissant sa souveraineté sur la Lotharingie occidentale.
Suite à la rencontre, Louis le Jeune et son
frère Charles levèrent une armée pour combattre Hugues, qui fut vaincu à
Verdun. En 882, le fils illégitime de Lothaire II reçut le duché
d’Alsace, mais il se rebella peu de temps après.
En 885, capturé par les troupes de Charles le
Gros, il fut aveuglé et enfermé dans le monastère de Prüm, où il mourut
en 895.
3° Louis III et Carloman II
contre la Provence (880 à 882) – Quelques mois après la mort de
Louis le Bègue, plusieurs comtes et ecclésiastiques de Provence se
réunirent au cours du concile de Mantaille, en octobre 879.
a) Boson, roi de Bourgogne (octobre 879) :
ces derniers, contestant les droits à la succession de Louis III et
Carloman II, considérés comme des enfants impuissants, décidèrent de
choisir comme souverain Boson, duc de Provence.
Quelques jours après, ce dernier fut proclamé
roi de Bourgogne à Lyon, par Aurélien, archevêque de cette ville,
puis installa sa capitale à Vienne, en Isère.
Cependant, Boson ne tarda guère à s’attirer
les foudres du pape Jean VIII, qui l’accusa d’être un usurpateur, mais
aussi des fils de Louis II, spoliés de la partie méridionale de leur
héritage.
b) Première guerre contre la Provence (880)
: suite à la signature du traité de Ribemont, Louis III,
Carloman II et leur cousin Charles le Gros prirent les armes contre
Boson.
Ces derniers, marchant vers la Bourgogne,
prirent Autun, Besançon, Chalon, Mâcon et Lyon. Acculé, l’usurpateur fut
contraint de se retirer vers Vienne, sa capitale.
Toutefois, à la même date, Charles le Gros fut
appelé à Rome pape le pape Jean VIII, qui souhaitait lui remettre la
couronne impériale.
Suite au départ de leur cousin pour l’Italie,
Louis III et Carloman II décidèrent alors d’abandonner le siège de
Vienne.
c) Deuxième et troisième guerre contre la
Provence (881 à 882) : l’année suivante, Carloman II lança une
nouvelle expédition contre le royaume de Bourgogne, alors que son frère
combattait les Normands. Puis, en 882, Carloman II assiégea Vienne une
fois encore, de concert avec son cousin Charles le Gros.
Mais, en août 882, Carloman II fut contraint
de lever le siège de Vienne, ayant appris la mort de son frère Louis
III. En septembre, il fut reconnu seul roi de Francie occidentale par
une assemblée de prélats réunie à Quierzy (Charles le Simple, demi-frère
de Carloman II, fut à nouveau écarté).
A Vienne, le siège de la ville fut continué
par Charles le Gros, qui reçut le soutien de Richard, comte de
Bourgogne, frère de Boson. L’usurpateur, quant à lui, parvint à se
réfugier en Provence.
4° Louis III et Carloman II
contre les Normands (879 à 884) – Les Normands, qui avaient diminué
leurs expéditions depuis la fin de règne de Charles le Chauve, lancèrent
de nouveaux raids à compter des années 880.
En effet, après une première phase consacrée
au pillage (s’étalant de 840 à 860), les envahisseurs organisèrent de
véritables opérations militaires à compter de la fin du siècle (ainsi,
les Normands s’installèrent en Angleterre à compter de 850).
a) Louis III contre les Normands (879 à
881) : en novembre 879, soit quelques semaines après leur
couronnement, Louis III et Carloman II attaquèrent une expédition
normande qui remontait la Vienne.
Les envahisseurs, vaincus, furent contraint de
reculer. Toutefois, ils revinrent l’année suivante, attaquant le nord du
pays, pillant Courtrai, Cambrai, Arras, et Amiens.
A l’été 881, alors que son frère assiégeait
Vienne, Louis III réunit son armée, puis affronta avec succès les
Normands lors de la bataille de Saucourt-en-Vimeu, près
d’Abbeville.
Cette victoire de Louis III eut un important
retentissement en Francie occidentale, les chroniques avançant le
chiffre de 8 000 mort côté viking.
b) Carloman II contre les Normands (882 à
884) : à la mort de Louis le Jeune, en janvier 882, mort sans
héritiers, Carloman II tenta de récupérer la Lotharingie occidentale,
qu’il avait cédé au défunt en 880. Toutefois, son cousin Charles, qui
avait récupéré l’héritage de son frère, ne voulut rien savoir.
Le roi de Francie occidentale n’eut pas plus
de succès contre les Normands, qui mirent en déroute l’armée royale près
d’Abbeville, en 883, puis pillèrent la Somme.
En 884, Carloman II réunit une assemblée à
Compiègne, au cours de laquelle il fut décidé de racheter le départ des
Normands. Ainsi, le roi des Francs fut contraint de céder 12 000 livres
d’argent aux envahisseurs, une somme considérable pour l’époque.
En décembre 884, Carloman II mourut à Bézu,
dans l’Eure, à la suite à un accident de chasse. Décédé sans héritiers à
l’âge de 17 ans, le roi de Francie occidentale fut enterré aux côtés de
son frère, dans l’église Saint Denis, à Paris.
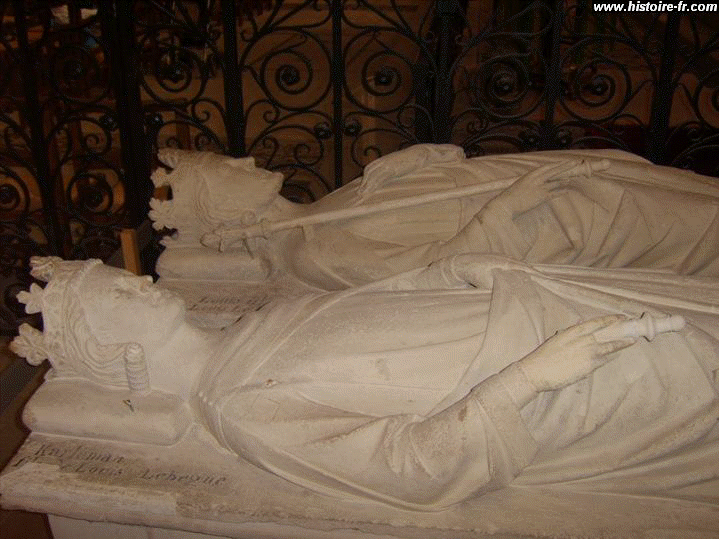
Gisants de Louis III et Carloman, réalisés
à la demande de Saint Louis, vers 1263-1264, église Saint Denis, Paris.
5° Charles le Gros seul roi
(884 à 887) – Carloman II n’ayant pas eu d’enfants, la couronne de
Francie occidentale fut cédée à Charles le Gros, qui officiellement
devait assurer la régence jusqu’à la majorité de Charles le Simple.
En début d’année 885, Charles le Gros était
Empereur, roi d’Italie, de Lotharingie, de Germanie et de Francie. Après
tant d’années de guerres civiles et de troubles, l’Empire de Charlemagne
se trouvait reconstitué une dernière fois. L’on attendait beaucoup de
Charles le Gros, mais au final, il ne parvint pas à s’imposer.
a) Charles le Gros et Boson (884) :
suite à la mort de Carloman II, l’Empereur décida de se rapprocher de
Boson. Ce dernier, vaincu à Vienne en 882, avait été contraint de se
réfugier en Provence, régnant sur une partie de ses anciens Etats.
Charles le Gros lui proposa de le reconnaitre
comme roi de Provence ; en échange, Boson devait prêter hommage à son
suzerain.
A sa mort, en 887, Boson céda le trône de
Provence à son fils Louis (surnommé plus tard l’Aveugle),
fils qu’il avait eu avec son épouse Ermengarde (il s’agissait de
la fille de Louis le Jeune).
b) Les invasions normandes en Lotharingie
(882) : à la mort de Louis le Jeune, en 882, les Normands
attaquèrent la Lotharingie, affaiblie par la disparition du roi. Les
Vikings, menés par leurs chef, Godfried, pillèrent de nombreuses
villes : Maëstricht, Lièges, Bonn, Cologne, Trèves, etc.
Réunissant l’armée royale, Charles le Gros
assiégea le camp des envahisseurs à Ascaloha, en Frise. Les deux
belligérants acceptèrent alors d’entamer des pourparlers : en échange du
duché de Frise, Godfried devait se faire baptiser et prêter allégeance à
Charles ; en outre, le Normand épousait Gisèle, fille de
Lothaire II.
Mais quelques années plus tard, craignant que
Godfried ne s’allie avec Hugues, fils illégitime de Lothaire II, Charles
le Gros décida d’attirer le Normand à une entrevue, où il le fit
assassiner (vers 885).
C’est à cette même date qu’Hugues fut capturé
par Charles le Gros, puis aveuglé en enfermé dans le monastère de Prüm.
b) Le siège de Paris (885 à 886) :
suite à la mort de Godfried, son frère Siegfried décida de
reprendre ses raids contre l’Empire carolingien.
A noter que le récit de cette expédition nous provient de la chronique
Le siège de Paris par les Normands, poème rédigé dix ans après
les faits par le moine Abbon, qui avait participé au conflit.
Siegfried, à la tête de 700 barques, portant
40 000 hommes,
s’empara de Rouen en juillet 885, contrôlant désormais l’embouchure de
la Seine. Puis il remonta le fleuve en direction de Paris.
En novembre 885, lors de l’arrivée des
Normands, l’ancienne capitale mérovingienne n’occupait guère que l’île
de la cité. Les habitants des rives vinrent alors se réfugier à l’abri
des murs de la ville.
A cette date, Siegfried s’entretint avec
Gozlin, évêque de Paris, lui demandant de laisser la flotte normande
traverser la Seine, en échange de quoi Paris ne serait pas attaquée.
Toutefois, Gozlin refusa de céder.
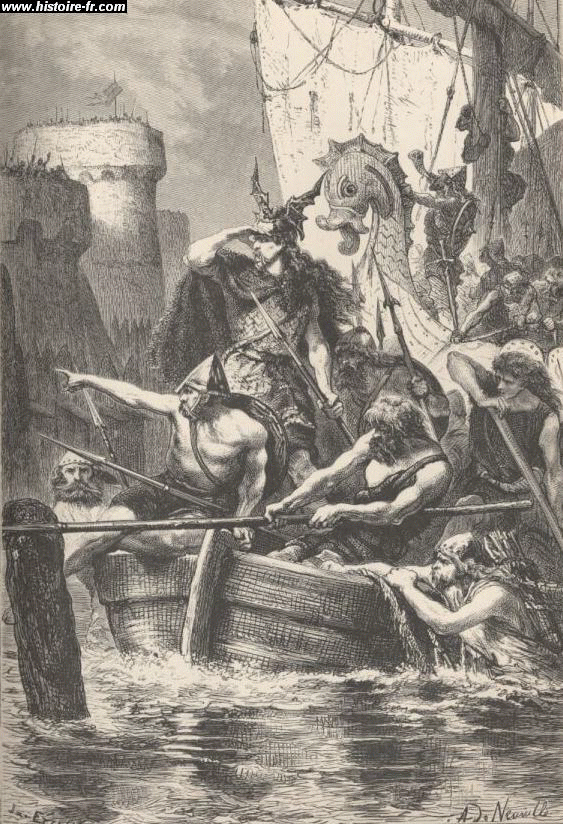
Les Normands attaquent Paris, gravure
issue de l'ouvrage Histoire de France, par François GUIZOT,
France, 1875.
A la fin du IX° siècle, seuls deux ponts
reliaient l’île de la cité aux berges de la Seine : le Grand-Pont
et le Petit-Pont.
Afin de protéger ces constructions, deux forteresses avaient été érigées
sur l’île de la cité sous le règne de Charles le Chauve : le Grand
Châtelet, protégeant le Grand-Pont ; et le Petit Châtelet,
protégeant le Petit-Pont.
Alors que la défense de la capitale avait été
confiée à Eudes, comte de Paris,
les Normands commencèrent à attaquer le Grand-Pont à la fin du mois de
novembre 885.
Pendant plusieurs jours, les envahisseurs
tentèrent de franchir le pont fortifié, mais ils en furent empêchés par
les défenseurs de la ville, qui firent pleuvoir flèches, pierres,
poutres et poix fondue sur les Normands.
Ayant perdu près de 300 hommes, Siegfried
décida de changer de tactique. Ce dernier, établissant un camp retranché
à Saint-Germain-L’auxerrois, entreprit alors d’assiéger Paris
(toutefois, le blocus fut imparfait, les Normands n’étant pas
suffisamment nombreux).
Pendant deux mois, les envahisseurs se
consacrèrent à la fabrication de matériel de siège. Dans sa chronique,
Abbon mentionne des béliers, des catapultes, mais aussi des chats
et des mantelets.
Au début du mois de février 886, les Normands
s’attaquèrent aux murailles de la ville, mais ils ne parvinrent pas à
approcher les béliers des portes de Paris. Ainsi, Siegfried décida
d’incendier les ponts de Paris grâce à des brûlots ;
toutefois, ces derniers heurtèrent les piles en pierre du Grand-Pont.
Les Parisiens éteignirent alors le brasier et s’emparèrent des brûlots.

Le comte Eudes défend Paris contre les
Normands, par SCHNETZ, XIX°,
château de Versailles, Versailles.
Le 6 février 886, après plus de deux mois de
siège, une crue emporta le Petit-Pont, qui reliait le Petit Châtelet à
l’île de la cité. Douze défenseurs se retrouvèrent isolés, entourés par
les Normands. Pendant toute la journée, ils tentèrent de faire face aux
assauts répétés de leurs assaillants. Au crépuscule, alors que la tour
était la proie des flammes, les survivants tentèrent une sortie. Ils
furent massacrés jusqu’au dernier par les Normands qui se jetèrent sur
eux. L’Histoire a conservé le nom de ces douze Parisiens : Aimard,
Arnaud, Gui, Hardre, Herland, Hermanfroi,
Hervé, Hervi, Jobert, Jossouin, Ouacre,
Seuil.
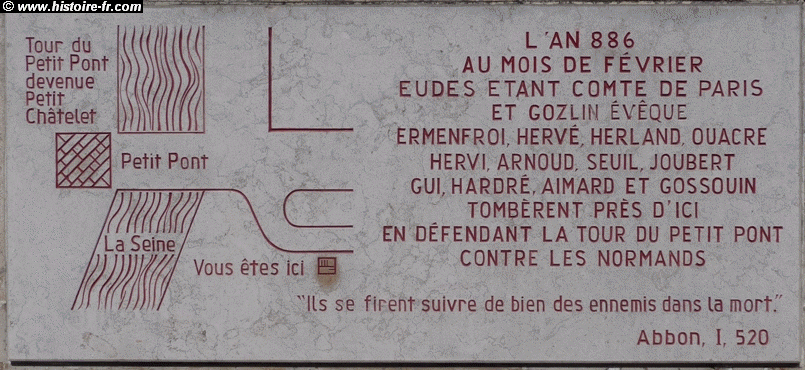
Plaque commémorative du combat, parvis Notre Dame, Paris.
Courant février, les Normands délaissèrent le
siège de Paris pour attaquer d’autres cités de la région. Ces derniers,
repoussés devant Chartres et le Mans, parvinrent toutefois à piller
Evreux.
En mars 886, Gozlin et Eudes décidèrent
d’entamer des pourparlers avec Siegfried, achetant son départ contre 60
livres d’argent. Payé, le chef des Normands s’attaqua à Bayeux, qui fut
rapidement conquise ; toutefois, de nombreux Vikings décidèrent de
poursuivre le siège de Paris.
Alors que la famine sévissait dans l’ancienne
capitale mérovingienne, l’évêque Gozlin mourut de la Peste (avril 886).
A cette date, le comte Eudes décida d’aller quérir l’aide de Charles le
Gros, qui résidait à cette époque à Metz. Il ne fut pas difficile de
sortir de Paris, les Normands ayant dédaigné les travaux d’encerclement.
Ayant rencontré l’Empereur, Eudes rentra non
sans mal dans
l’ancienne capitale au cours du mois de juin, mais l’armée royale
n’arriva à Paris qu’à compter du mois de septembre 886.
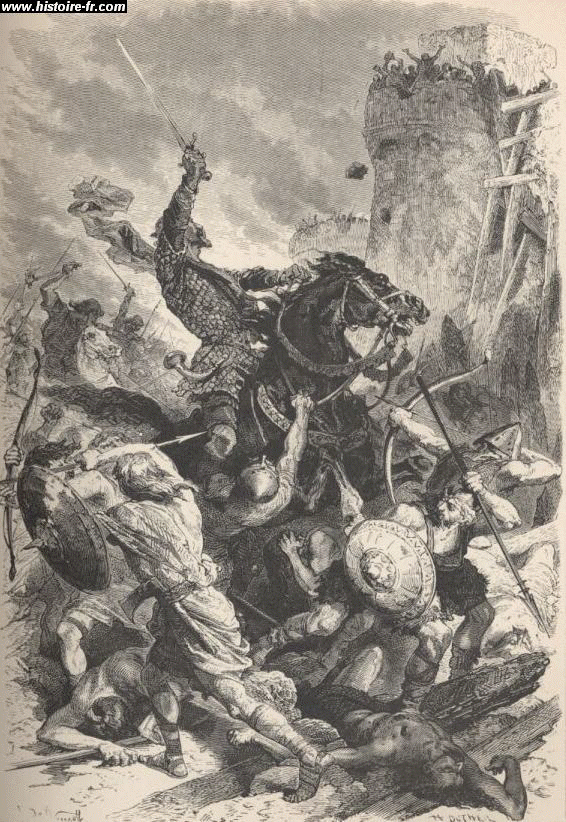
Eudes parvient à rentrer dans Paris, gravure issue de l'ouvrage Histoire de France, par
François GUIZOT, France, 1875.
A cette date, Charles le Gros entama des
négociations avec les Normands : ces derniers recevaient l’autorisation
de piller la Bourgogne ; à leur retour, au printemps 887, leur serait
cédée une indemnité de 700 livres d’argent.
A noter que ces négociations ternirent
considérablement le prestige de l’Empereur.

Charles le Gros devant Paris, par Paul Lehugeur, XIX°
siècle.
Les Normands n’ayant pas eu la permission de
traverser les ponts de Paris, ils furent contraints de tirer leur
navires sur la terre ferme jusqu’aux rives de la Marne.
Ces derniers pillèrent alors l’abbaye de Saint
Germain à Auxerre, puis Bèze et Flavigny.
Au mois de mai 887, les envahisseurs
retournèrent à Paris, où ils reçurent les 700 livres promises par
Charles le Gros. Toutefois, ces derniers repassèrent les ponts de
l’ancienne capitale par surprise, dénonçant ainsi l’accord passé avec
l’Empereur.
6° La fin de règne de Charles
le Gros, sa déposition (887) – Charles le Gros, dont l’autorité sur
l’Empire était très instable, commença à souffrir d’obésité et de folie
au cours des dernières années de son règne.
C’est ainsi qu’il fut de plus en plus contesté
par l’aristocratie, aussi bien en Germanie qu’en Francie.
a) Charles le Gros à la recherche d’un
héritier (887) : de son premier mariage avec Richarde,
Charles le Gros n’avait pas eu d’enfants. A la fin de son règne,
l’Empereur tenta donc de faire légitimer son fils Bernard, qu’il
avait eu avec une concubine dont nous ne connaissons pas le nom.
En mai 887, Richarde, accusée d’adultère, fut
répudiée. Charles, quant à lui, tenta de faire légitimer Bernard par la
papauté, qui ne voulut rien entendre. Sentant sa fin approcher,
l’Empereur décida de reconnaitre comme fils adoptif Louis l’Aveugle, roi
de Provence.
Pendant l’été, ce dernier reçut alors la
visite d’Eudes, comte de Paris, et de Bérenger, marquis de Frioul.
Les deux hommes, sachant le roi malade, souhaitait vraisemblablement
récupérer la couronne de leurs Etats respectifs.
b) La déposition de Charles le Gros
(novembre 887) : en fin d’année 887, Charles le Gros, malade, fut
contraint de faire face à la révolte de son neveu Arnulf, fils
illégitime de Carloman de Bavière.
En novembre 887, Charles le Gros fut déposé
lors de la diète de Tribur, puis enfermé dans le monastère de
Reichenau (où il mourut en janvier 888).
A cette date, Arnulf fut nommé roi de Germanie par une assemblée de
prélats.
Bernard, écarté de la succession, se rebella
contre Arnulf, mais il fut tué vers 891.
En Francie occidentale, la déposition de
l’Empereur n’eut pas de conséquences. Ce n’est qu’à la mort du souverain
déchu que les grands du royaume procédèrent à une élection, afin de
choisir un nouveau roi (le titulature impériale fut abandonnée pendant
quelques années).
En Europe, plusieurs souverains émergèrent de
ce nouveau morcellement de l’Empire carolingien : en Francie, Eudes,
comte de Paris ; En Germanie, Arnulf, duc de Carinthie ; en Italie,
Bérenger, marquis de Frioul (ce dernier fut toutefois renversé dès 889
par Guy, duc de Spolète) ;
en Provence, Louis l’Aveugle ; en Aquitaine, Ranulf, qui ne
reconnaissait pas Eudes ; et en Bourgogne, Rodolphe I°, qui
refusait la domination d’Arnulf.
A noter que Charles le Gros fut le dernier
souverain à réunir l’ancien Empire de Charlemagne (à l’exception de la
Bretagne et de la Provence). Sa déposition consacra le morcellement de
l’Empire carolingien, mais aussi la lente déchéance de cette dynastie
royale.
En outre, il convient de préciser que le règne
de ce souverain fut bien plus critiqué par les historiens du XIX° siècle
que par les contemporains de Charles le Gros, d’où cette vision quelque
peu négative qui prédomine encore aujourd’hui.