|
1° Un gouvernement libéral –
Le 5 septembre 1816, date de la rentrée politique, le roi de France annonça
la dissolution de la chambre introuvable, signant une ordonnance prévoyant
l’élection d’une nouvelle assemblée.

Buste de Louis XVIII, musée
des Invalides, Paris.
Cette décision enchanta les libéraux aussi bien qu’elle consterna la Cour et
les Ultras. Elie Decazes, ministre de a Police, décida de prendre en main
les nouvelles élections législatives, veillant à faire élire des députés
libéraux ; en outre, il fit remplacer les préfets proches des
ultraroyalistes par des modérés.
a)
Une série de lois libérales : les élections législatives, grâce à
l’action de Decazes, entraîna l’élection de nombreux députés libéraux.
Ainsi, la nouvelle Chambre des députés vota une série de mesures libérales
entre 1817 et 1818 : la loi Laîné (8 février 1817.), prévoyait un
renouvellement de l’assemblée par tiers chaque année, les élections se
faisant grâce à un collège d’électeurs réunis au chef lieu du département
(ainsi, les Ultras étaient défavorisés au profit des libéraux.) ; loi
Gouvion Saint Cyr (mars 1818.), interdisant aux nobles d’entrer dans
l’armée en tant qu’officiers, et établissant le tirage au sort lors du
recrutement (l’objectif était de renforcer l’armée française, qui ne
comptait que 100 000 hommes en 1815.).
b)
La disette de l’été 1817 : à noter toutefois qu’une disette frappa la
France au cours de l’été 1817, la récolte de l’année précédente ayant été
mauvaise (l’ensemencement de 1815 n’ayant pu se dérouler dans de bonnes
conditions à cause de l’occupation étrangère.).

L'armée prussienne défile dans Paris.
C’est dans la région du Rhône, et principalement à Lyon, que les émeutes
furent les plus violentes. Ainsi, de nombreux insurgés appelèrent
Napoléon II au pouvoir, brandissant des drapeaux tricolores.
La
révolte, présentée comme un coup d’Etat bonapartiste par les Ultras, fut
réprimée de façon particulièrement féroce. 28 émeutiers furent condamnés à mort, 34 d’entre
eux furent déportés. En outre, l’armée fut chargée d’occuper la cité.
Toutefois, des émeutes eurent lieu dans d’autres régions de France, le prix
du pain ayant grimpé jusqu’à atteindre le salaire journalier d’un ouvrier.
Ainsi, près de 2 000 condamnations furent prononcées contre les insurgés,
bien que le gouvernement décida d’accorder une amnistie à certains prévenus.
Par ailleurs, afin de faire face à la crise, Louis XVIII décida de faire
importer du blé de Russie.
c)
La fin de l’occupation étrangère : en 1818 arrivait l’expiration des
trois années minimum d’occupation du territoire français par les puissances
européennes. Ainsi, le duc de Richelieu signa le 10 février 1818 une
convention prévoyant le départ d’un cinquième des troupes étrangères, contre
le paiement d’une indemnité de 265 millions (contre les 700 prévus lors de
la signature du traité de Paris.).
Afin de trouver la somme nécessaire, le duc de Richelieu décida de lever un
nouvel emprunt, parvenant à récolter plus de cent millions de francs.
Finalement, lors du Congrès d’Aix la Chapelle (septembre à octobre
1818.), les puissances européennes décidèrent d’évacuer totalement le
territoire français. Le départ des troupes étrangères fut fixé à la fin
novembre 1818, bien que certains souverains aient émis des doutes quant au
bien fondé du mouvement libéral.
A
noter toutefois que cette décision fut obtenue grâce à l’amitié qu’éprouvait
le tsar Alexandre pour le duc de Richelieu. La position du souverain russe
n’était toutefois pas désintéressée. En effet, ce dernier préférait que la
France se rapproche de la Russie plutôt que de l’Angleterre ou de
l’Autriche.
Enfin, la France fut autorisée à rejoindre la
Sainte Alliance,
coalition chargée de lutter contre les mouvements révolutionnaires.
2° La démission de Richelieu, le ministère Dessolles
(décembre 1818 à novembre 1819) – En octobre 1818, de nouvelles
élections eurent lieu. Si les Ultras furent battus une fois de plus, la
nouvelles Chambre des députés vit apparaitre un nouveau parti, les
indépendants.
Dans un premier temps, ce courant ne fut qu’une branche des libéraux ; mais
au fil du temps, ce parti parvint à s’organiser aussi bien que les Ultras
(l’on y retrouva alors de nombreux bonapartistes, hostiles aux Bourbons.).
Suite aux élections de 1818, le duc de Richelieu se trouvait dans une
situation délicate. En effet, le premier ministre était royaliste, mais il
devait s’appuyer sur les libéraux afin de lutter contre les Ultras (à noter
que ces derniers étaient constamment surveillés par Decazes, alors ministre
de la Police.).
Richelieu, refusant de s’attaquer aux membres de son propre camp, décida
alors de présenter sa démission à Louis XVIII le 21 décembre 1818.
a)
La nomination de Dessolles : Decazes étant trop jeune pour être nommé
premier ministre, la charge fut alors confiée au général Jean Joseph
Dessolles, commandant de la Garde nationale (ce dernier, disgracié en
1806 par Napoléon en raison de ses propos litigieux, avait toutefois
participé à la guerre d’Espagne et à la campagne de Russie. Affichant son
hostilité à Napoléon lors des Cent-Jours, Dessolles décida finalement de
rallier les Bourbons lors de la restauration.).
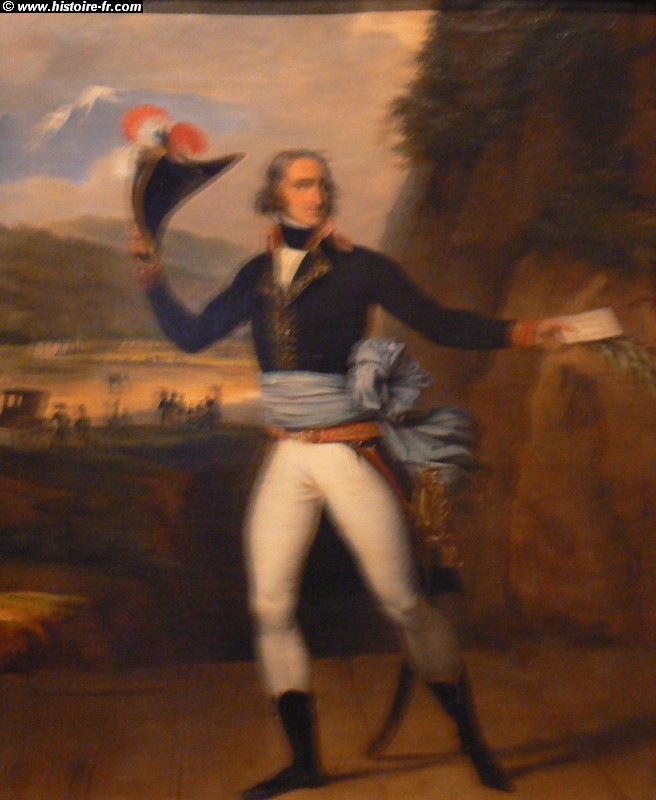
Le général Jean Joseph Dessolles, par Louis Edouard RIOULT,
1836, musée des Invalides, Paris.
Le
nouveau ministère, auquel participèrent entre autres Gouvion Saint Cyr
(Guerre.), Decazes (Intérieur.),
Joseph Dominique, baron Louis (Finances.), et Pierre François Hercule,
comte de Serre (Justice.), fut aussi libéral que le précédent (à noter que
Dessolles s’occupa des affaires étrangères, à l’instar de son
prédécesseur.).
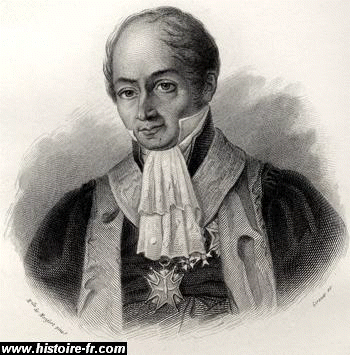
Pierre François Hercule, comte de Serre.
Le
nouveau premier ministre, soucieux de développer l’économie du pays, mit en
place une série de mesures protectionnistes (afin de lutter contre la
concurrence anglaise.), et favorisa les échanges commerciaux avec les îles
des Caraïbes.
A
noter que c’est à cette époque que commença à se développer la révolution
industrielle, entraînant une hausse de la productivité.
En
janvier 1819, François Guizot, un membre du parti doctrinaire, fut
nommé directeur général de l’administration départementale et communale.
Ce dernier, travaillant de concert avec Decazes, publia plusieurs
ordonnances, réclamant la destitution d’une quarantaine de préfets et sous
préfets trop favorables aux Ultras.
Ces derniers furent alors remplacés par des libéraux ou d’anciens
fonctionnaires de l’Empire.
Le
2 mars, la Chambre des pairs demanda à Louis XVIII de modifier le scrutin
électoral, afin de favoriser l’élection des Ultras. Toutefois, Decazes
décida de répliquer en obtenant du roi de France la nomination de 60
nouveaux pairs (ces derniers avaient été choisis parmi les libéraux, et une
partie d’entre eux avaient siégé lors des Cent-Jours.).
L’objectif de la manœuvre était de rejeter le projet de loi de la Chambre
des pairs en y faisant rentrer des opposants aux Ultras.
Puis, le 22 mars, la Chambre des députés vota la loi Serre, texte
prévoyant une atténuation de la censure : restait punissable l’apologie du
crime, l’outrage à la morale ou à la religion, l’offense envers le roi ou
les autorités, ainsi que la diffamation ; les délits de presse seraient
punis d’une amende et non plus d’une déportation ; enfin, l’autorisation
préalable, autrefois nécessaire à la création d’un journal, était
supprimée.
b)
Les limites du libéralisme : lors des élections de septembre 1819,
les libéraux décidèrent de présenter leurs candidats face à ceux du
gouvernement (alors que Dessolles était favorable au libéralisme.). Jouant
la carte du bonapartisme (diffusion d’ouvrages rappelant la gloire de
l’Empire et hostiles aux Bourbons.), les libéraux remportèrent ainsi de
nombreux sièges à l’assemblée (à noter que les nouveaux députés furent élus
grâce au report de voix des Ultras, ces derniers ayant refusé de voter pour
les candidats du gouvernement.).
C’est ainsi que furent élu le général Maximilien Sébastien Foy, ayant
participé à la campagne d’Espagne et aux Cent-Jours ; ainsi que l’abbé
Henri Grégoire.

Le général Foy, attribué à Pierre VIGNERON, première moitié du
XIX° siècle, musée Carnavalet, Paris.
Ce
dernier, né en décembre 1750, avait participé à la Révolution française
depuis ses débuts : député du clergé aux Etats Généraux de 1789, l’abbé
était présent lors du serment du jeu de paume, prêta serment à la
Constitution civile du clergé, prit part au jugement de Louis XVI,
et vota la première abolition de l’esclavage (février 1794.).
Sous l’Empire, l’abbé Grégoire fut élu sénateur, mais adopta une position
hostile à Napoléon (il s’opposa à la création de l’Empire et de la nouvelle
noblesse, mais aussi au divorce de Joséphine.).
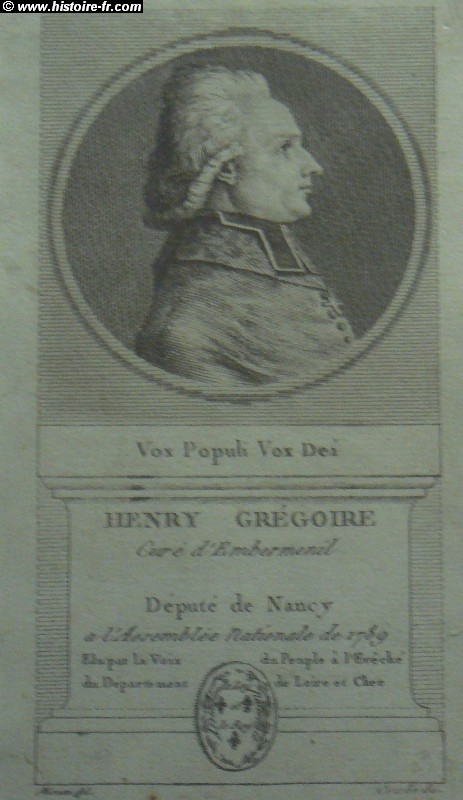
L'abbé Grégoire, par Wilbrode Magloire COURBE, musée Carnavalet, Paris.
L’arrivée de députés tels que Foy et Grégoire à l’assemblée effraya les
membres du gouvernement, qui redoutaient la formation d’une chambre
majoritairement libérale d’ici un à deux scrutins partiels.
Decazes, se rapprochant des royalistes, décida alors de mettre en place un
projet de réforme électorale, prévoyant un doublement du Cens et la
possibilité de voter deux fois pour les électeurs les plus riches.
En
novembre 1819, lors de la présentation du projet de loi au gouvernement,
trois ministres libéraux décidèrent de démissionner : Dessolles, Gouvion
Saint Cyr et le baron Louis.
3° Le court ministère Decazes, l’assassinat du duc de Berry
(novembre 1819 à février 1820) – Suite à la démission de Dessolles, Elie
Decazes fut chargé par Louis XVIII de former un nouveau gouvernement.
a)
Decazes face aux critiques : bien que tentant de mettre en place un
ministère faisant le consensus, le nouveau premier ministre fut vivement
critiqué par les Ultras (qui critiquaient son libéralisme.), ainsi que par
les libéraux (qui jugeaient Decazes comme un traitre, l’abbé Grégoire ayant
été exclu de l’assemblée le 29 novembre 1819.).
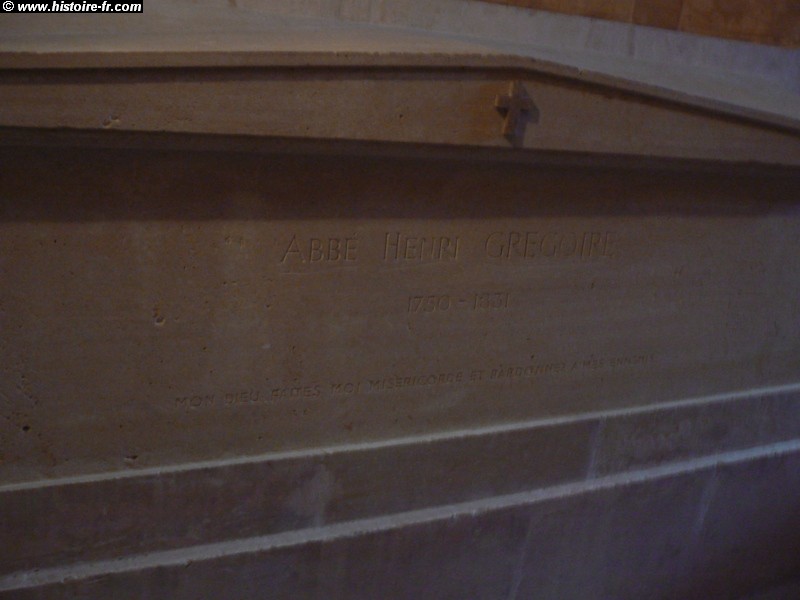
Tombe de l'abbé Grégoire, le Panthéon, Paris.
Alors que le projet de réforme électorale était débattu à la Chambre des
députés, le comte de Serre, ministre de la Justice, décida de démissionner
(21 janvier 1820.). La défection de ce ministre populaire fut un coup dur
pour Decazes, mais un évènement bien plus grave causa définitivement sa
perte.
b)
L’assassinat du duc de Berry : en effet, la carrière politique d’Elie
Decazes fut brisée net dans la nuit du 13 au 14 février 1820, date à
laquelle fut assassiné Charles Ferdinand d’Artois, duc de Berry.

Charles Ferdinand d'Artois, duc de Berry,
par jean François THUAIRE, début du XIX° siècle, musée Carnavalet, Paris.
Le
défunt, né en janvier 1778, était le fils de Charles, comte d’Artois (futur
Charles X.), et de son épouse
Marie Thérèse de Sardaigne. Le duc de
Berry, encore un enfant lors du déclenchement de la Révolution française,
suivit son père lors de l’émigration. Se rendant plus tard en Angleterre, il
y épousa secrètement Amy Brown (deux filles naquirent de cette
union.).
Retournant en France lors de la restauration, il épousa alors Caroline
en 1816 (la mariée était la fille de François I°, roi des
Deux-Siciles.).

La duchesse de Berry,
par LAWRENCE, 1825, château de Versailles,
Versailles.
Réputé proche des Ultras, le duc de Berry sortait de l’opéra de la rue de la
loi,
lorsqu’il fut frappé d’un coup de poignard au cœur par son assassin. Le
meurtrier de Charles Ferdinand, un ouvrier bonapartiste
nommé Louis Pierre Louvel, fut rapidement arrêté. Lors de son
interrogatoire, il déclara avoir voulu éteindre la dynastie des Bourbons.
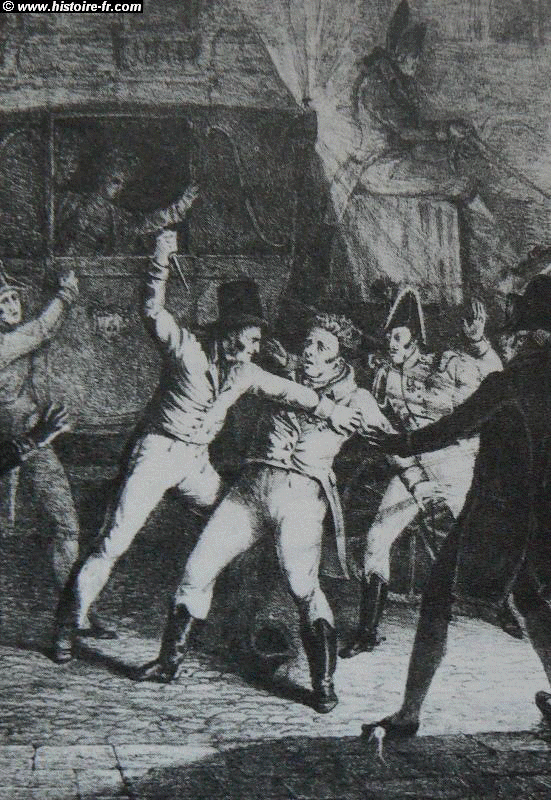
L'assassinat du duc de Berry.
Ayant réclamé la grâce de son assassin alors qu’il se trouvait sur son lit
de mort, le duc de Berry s’éteignit après quelques heures d’agonie (Louvel,
quant à lui, fut guillotiné quatre mois plus tard.).

La mort du duc de Berry, par François Barthélémy CIBOT, début
du XIX° siècle, musée Carnavalet, Paris.
Toutefois, Louvel ignorait que Caroline, l’épouse du défunt, était alors
enceinte. Le 29 septembre 1820, elle accoucha d’un fils, Henri, qui
fut le dernier descendant direct de Louis XV.

Présentation par la duchesse de
Berry de son fils, le duc de Bordeaux, au corps constitué, en septembre 1820,
par LAFONT, début du XIX° siècle, château de Versailles, Versailles.
c)
L’éviction de Decazes : Suite à l’assassinat, les Ultras se
déchainèrent contre Decazes, jugé responsable du meurtre. Dans un premier
temps, Louis XVIII décida de soutenir son premier ministre ; Decazes, quant
à lui, tenta de recueillir le soutien du duc de Richelieu.
Finalement, poussé à la démission par ses adversaires, le premier ministre
décida de d’abandonner ses fonctions le 20 février 1820. Louis XVIII,
reconnaissant envers son favori, le titra duc et le nomma ambassadeur de
Grande Bretagne.
Certains historiens considèrent que le roi de France, suite au renvoi de
Decazes, cessa de s’intéresser aux affaires de l’Etat.
|