|
1° L’arrestation des ministres de
Charles X (été 1830) – Au cours du mois d’août, plusieurs ministres de
Charles X furent arrêtés alors qu’ils fuyaient le pays. Les prévenus étaient
Jules Auguste Armand Marie, comte de Polignac
(premier ministre de Charles X.) ; Pierre Denis, comte de Peyronnet
(ancien ministre de l’Intérieur.) ; Jean Claude Balthazar Victor de
Chantelauze (ancien ministre de la Justice.) ; et Martial Côme
Annibal Perpétue Magloire, comte de Guernon Ranville (ancien ministre de
l’Instruction publique et des Cultes.)

Armand Marie, comte de Polignac.
Rapidement, l’annonce de la capture de ces quatre politiciens entraîna de
vifs échanges à la Chambre des députés.
2° Les premiers débats entraînent une dislocation du
gouvernement (octobre à novembre 1830) – Très rapidement, il fut décidé
de passer les anciens ministres en jugement, mais les députés les plus
révolutionnaires réclamèrent qu’ils soient condamnés à mort pour haute
trahison. Cependant, afin de couper l’herbe sous le pied à l’extrême gauche,
certains élus proposèrent l’abolition de la peine de mort.
Louis Philippe, ne souhaitant pas que les ministres soient mis à mort, se
prononça en faveur de l’abolition, ce qui provoqua un tollé chez les
républicains et les révolutionnaires.
Ainsi, à la mi-octobre, des émeutiers marchèrent sur le Palais Royal (il
s’agissait de la résidence des ducs d’Orléans depuis le règne de Louis XIV.). Au
même moment, des manifestants se trouvaient au fort de Vincennes, réclamant
les prisonniers afin de les lyncher.
Toutefois, la Garde nationale parvint à contenir les mécontents.
Suite à ces altercations, le ministre de l’Intérieur, François Guizot,
réclama la destitution d’Odilon Barrot, préfet de Paris. En effet, ce
dernier avait qualifié l’abolition de la peine de mort d’inopportune
démarche.
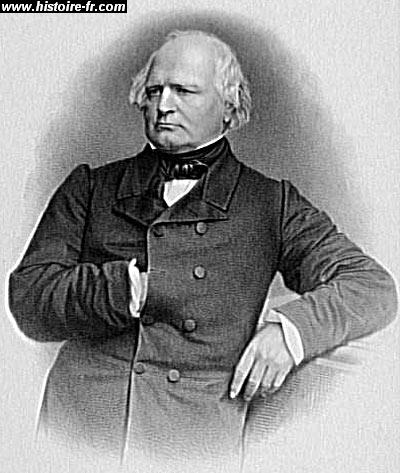
Odilon Barrot.
Toutefois, Dupont de l’Eure, proche des républicains, refusa de se plier à
la politique de fermeté prônée par Guizot. Ainsi, il annonça qu’il
quitterait le gouvernement si Odilon Barrot était révoqué.
Louis Philippe décida alors de se rapprocher des libéraux, donnant au
banquier Jacques Laffitte la tâche de former un nouveau gouvernement
(2 novembre 1830.).
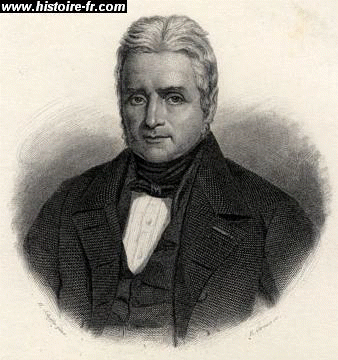
Jacques Laffitte.
Guizot et de Broglie, refusant de participer à ce ministère, décidèrent
donc de démissionner.
3° Un gouvernement long à mettre en place (novembre 1830) –
Suite à la nomination de Laffitte, de longues négociations furent
nécessaires pour mettre en place le nouveau gouvernement.
Le
nouveau premier ministre, récupérant le portefeuille des Finances, laissa à
leurs postes Dupont de l’Eure (Justice.), Maurice Etienne Gérard (Guerre.)
et Sebastiani (Marine.).
Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur fut confié à Camille Bachasson,
comte de Montalivet ;
le maréchal Nicolas Joseph Maison
eut les Affaires étrangères ; et
Joseph Mérilhou
fut nommé ministre de l’Instruction publique et des Cultes.
 
Camille Bachasson, comte de Montalivet (à
gauche.) ; Nicolas Joseph Maison, XIX° siècle, musée des
Invalides, Paris (à droite.).
A
noter enfin que le journaliste Adolphe
Thiers
fut nommé sous-secrétaire d’Etat aux Finances.

Adolphe Thiers.
Toutefois, un remaniement ministériel intervint dès la mi-novembre 1830.
Ainsi, Sebastiani remplaça le maréchal Maison aux Affaires intérieures ;
Nicolas Jean de Dieu Soult (il s’agissait d’un des maréchaux de
Napoléon.) fut nommé ministre de la Guerre ; Antoine Maurice Apollinaire,
comte d’Argout,
reçut le portefeuille de la Marine et des Colonies.
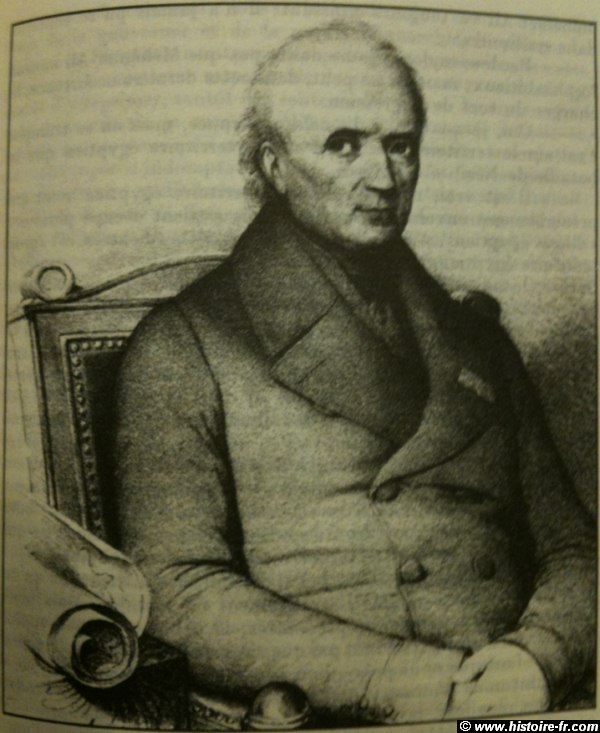 
Le maréchal Nicolas Jean de Dieu Soult, illustration issue de
l'ouvrage Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps, par
François GUIZOT
(à gauche.) ; Antoine Maurice Apollinaire, comte d'Argout, par
Honoré DAUMIER, XIX° siècle, musée d'Orsay, Paris (à droite.).
4° Le procès des ministres de Charles X (décembre 1830) –
Le 15 décembre 1830, le procès de quatre ministres de Charles X s’ouvrit au
palais du Luxembourg (il s’agissait du siège de la Chambre des pairs.).
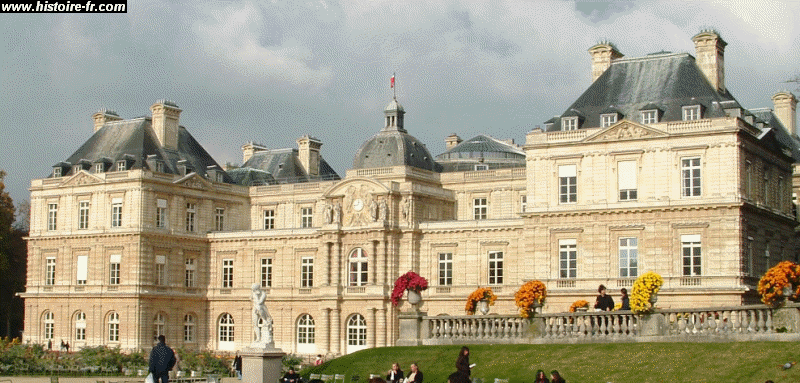
Le Palais du Luxembourg, Paris.
L’accusation retint trois charges contre les prévenus : abus de pouvoir lors
des élections législatives de l’été 1830 ; violation de la Charte de 1814
par les quatre ordonnances de Saint
Cloud ;
et attentat contre la sûreté de l’Etat par incitation à la guerre civile.
Les avocats de la défense, quant à eux, rappelèrent au jury que les abus
commis lors de la Révolution française avaient entraîné la mort de bien des
innocents.
A
l’extérieur du Palais du Luxembourg, la foule en colère manifestait son
mécontentement. Toutefois, la Garde nationale, commandée par Marie Joseph
Paul Yves Roch Gilbert du Motier, marquis de La Fayette, parvint à
contenir les manifestants hostiles aux quatre prévenus.

Le marquis de La Fayette,
1824.
Finalement, les juges rendirent leur verdict à la fin décembre 1830. Les
ministres de Charles X ne furent pas condamnés à mort, mais à la prison à
vie.
A
l’annonce du verdict, les manifestants se dispersèrent peu à peu, puis le
calme revint dans Paris.
Suite au procès, Louis Philippe décida de se séparer de La Fayette, qu’il
considérait comme trop instable à son goût. Le commandant de la Garde
nationale fut alors contraint de démissionner, adoptant à nouveau une
existence parlementaire.
Dupont de l’Eure, le ministre de la Justice, décida de démissionner
afin de montrer sa désapprobation au roi des Français (il fut alors remplacé
par Joseph Mérilhou, dont le portefeuille de l’Instruction publique et des
Cultes fut confié à Félix Barthe.).

Félix Barthe, par Honoré DAUMIER, 1833, musée d'Orsay, Paris.
A
noter toutefois qu’aucun des condamnés ne mourut en prison. Ainsi,
Chantelauze, le comte de Peyronnet et le comte de Guernon Ranville furent
respectivement libérés en avril, octobre et novembre 1836 ; Polignac, quant
à lui, vit sa peine se commuer en vingt années de bannissement en novembre
1836 (il mourut néanmoins à Paris en 1847.).
|