|
1° Les Malcontents s’allient aux
huguenots – En accédant au pouvoir, Henri III découvrit une France plus
divisée que jamais entre catholiques et protestants, les nombreuses guerres
de religion n’ayant réussi qu’à attiser les haines entre les deux camps.

Henri III, roi de France, atelier de
Germain Pilon, fin du XVI° siècle, musée du Louvre, Paris.
Par ailleurs, des querelles politiques s’étaient greffées sur les querelles
religieuses à la fin du règne de Charles IX, les Malcontents ayant fait
savoir leurs revendications au défunt roi de France (écoutés dans un premier
temps, ils furent punis par la suite.).
Ainsi, en septembre 1575, Condé, assisté par les mercenaires allemands de
l’électeur palatin Frédéric III,
pénétra en Champagne, bien décidé à en découdre une fois de plus avec la
royauté.

Portrait d'Henri I°, prince de Condé.
Au
même moment, François d’Alençon, le jeune frère d’Henri III, jugeait qu’en
tant qu’héritier de la couronne,
il n’avait pas reçu les apanages auxquels il estimait avoir droit. Ainsi, il
décida de se révolter une fois de plus et s’enfuit de la Cour.

Portrait de François, duc d'Alençon.
Cette situation était particulièrement dangereuse pour la couronne car, en
présence du frère du roi, elle donnait aux réformés une apparence de
légitimité. Catherine de Médicis décida alors de rencontrer son fils cadet à
Chambord, à la fin septembre 1575.
Elle lui promit alors de libérer François de Montmorency et Cossé,
embastillés depuis avril 1574, suite à la seconde conjuration des
Malcontents.
Henri III, quant à lui, refusa d’imiter l’attitude conciliante de sa mère,
jugeant qu’il fallait être intraitable avec les insurgés.
2° La bataille de Dormans (octobre 1575) – Apprenant que
les huguenots s’étaient alliés aux Malcontents, Henri, duc de Guise, décida
alors d’en découdre avec les rebelles. Les deux belligérants s’affrontèrent
alors au cours de la bataille de Dormans, dans la Marne (octobre
1575.).

Portrait d'Henri de Lorraine, duc de
Guise, vers 1580, musée Carnavalet, Paris.
L’armée royale parvint à l’emporter, mais le duc de Guise reçut une blessure
au visage qui lui valut son surnom de Balafré.
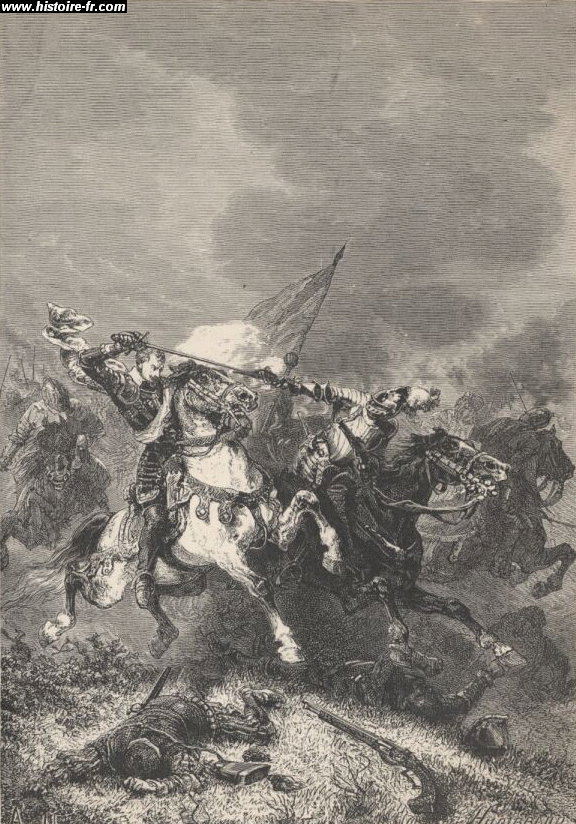
Henri de Guise blessé lors de la bataille de Dormans, gravure issue de
l'ouvrage
Histoire de France, par François GUIZOT, France, 1875.
Toutefois, l’armée royale ne parvint pas à profiter de cette victoire, car
Jean Casimir, fils de l’électeur palatin Frédéric III, pénétra dans l’est de
France à la tête d’une importante armée.
3° La fin de la cinquième guerre de religion – François
de Montmorency, sorti de la Bastille début novembre 1575, décida de mettre
en place des négociations, obtenant une trêve de la part des belligérants.
A
la fin du mois de novembre, le frère du roi ratifia la trêve, acceptant un
armistice de six mois. Certaines cités furent alors données en gage aux
protestants, telles que Bourges, La Charité sur Loire, Angoulême, etc. Cette
annonce provoqua la colère et la résistance de ces différentes cités.
Profitant de ces évènements, Henri, roi de Navarre, parvint à s’évader de la
Cour en février 1576 (il était assigné à résidence depuis août 1572.). Il
traversa alors la Normandie afin de s’installer à Saumur.
La
position du roi de France étant devenue précaire, Catherine de Médicis
persuada ce dernier de faire la paix avec les Malcontents et les huguenots.

Catherine de Médicis, par Germain PILON,
vers 1575, musée du Louvre, Paris.
En
avril 1576, un premier traité fut signé à Etigny, confirmé par l’édit de
Beaulieu au mois de mai.
Répondant aux aspirations des Malcontents et des protestants (il fut aussi
appelé Paix de Monsieur, du fait du rôle qu’avait joué François
d’Alençon lors du conflit.),
ce traité constituait un véritable camouflet pour Henri III.
D’un point de vue religieux, le texte était le plus libéral des édits
promulgués jusqu’alors. En effet, les réformés jouiraient d’une grande
liberté de culte (hormis à Paris et à la Cour.), les victimes de la Saint
Barthelemy seraient indemnisées, et des cimetières protestants seraient
créés.
Par ailleurs, les huguenots conservaient les cités qu’ils avaient prises
lors de la guerre, ainsi que plusieurs autres cités.
Les Malcontents, tels que François de Montmorency, Cossé et Damville
retrouvaient leurs charges ; François d’Alençon reçut l’Anjou, la Touraine,
le Maine et le Berry, ainsi que La Charité sur Loire ; Henri de Navarre
reçut la Guyenne ; Condé fut confirmé en Picardie.
Enfin, Henri III s’engageait à réunir les Etats Généraux dans un délai de
six mois, et renonçait à poursuivre les pillards, accordant à Jean Casimir
le duché d’Etampes et une pension annuelle.
Ce
traité de paix fut d’un coût si exorbitant pour la royauté que Catherine de
Médicis fut contrainte de vendre ses bijoux, et la noblesse catholique fut
contrainte de se cotiser afin de payer la dette (le duc de Guise et le pape
firent ainsi d’importants dons financiers.).
Humiliés, les
catholiques commencèrent à constituer les premières ligues, afin de
se défendre contre les protestants. Ainsi, les habitants de Péronne, Roye et
Montdidier refusèrent d’ouvrir leurs portes au prince de Condé (Henri de
Guise décida de venir en aide à ces cités en juillet 1576.).
|